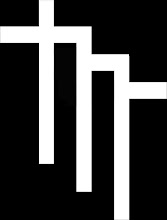A quoi sert la culture ?
Voilà une question que vous vous êtes sans doute souvent posée. A faire de vous une star du porno « hype », n’est sans doute pas la réponse que vous avez apporté le plus fréquemment. C’est pourtant bel et bien le cas pour Sasha Grey, actrice principale du dernier Steven Soderbergh (
Girlfriend Experience) mais aussi d’autres productions plus indépendantes et confidentielles auparavant.
Alors que l’on vous expliquait récemment comment
Lady Gaga est devenue un personnage pertinent, prescripteur, par le recours immodéré à des stratégies issues de l’art contemporain, un autre personnage sulfureux cherche à s’anoblir par la culture et à sortir de l’ombre envahissante.
Sasha Grey choisit une option différente de Lady Gaga, couverture médiatique réduite oblige. Elle, qui souhaitait à l'origine prendre Anna Karina comme pseudo, expose, en dehors de son corps (point partagé, dans une moindre mesure, par Lady Gaga), une connaissance quasi-encyclopédique, best-ofienne, de la culture underground internationale, toutes époques confondues, tous domaines épuisés : Faust, Throbbing Gristle, Sunn O))), Mayhem, Death from above 1979, Coil, NIN, Tool… pour la musique / Godard, Antonioni, Van Sant, Lynch, Corine, Clark, Bertolucci, Malle… pour le cinéma / Baudrillard, Nietzsche, Brecht, Burroughs, Sartre, Warhol… pour la littérature. On frôle franchement l’overdose. Alors, pourquoi une telle débauche, pourquoi un
name-dropping à la limite de la caricature ? Pour sortir du porno la tête haute ? Même pas.

A quoi sert la contre-culture ?
Sasha Grey qui se définit comme existentialiste, pornstar et artiste, ne souhaite pas, a priori, arrêter les films pour adulte. Elle ne peut décemment pas non plus mener une lutte perdue d’avance dans une Amérique puritaine pour un retour libre à la pornographie du type fin 1960’. Que cherche-t-elle à faire ?
A réhabiliter une contre-culture moribonde ? En réintégrant la pornographie dans le champ d’une sous-culture complexe, vénérée, influente, elle permet de créer un lien entre deux univers aux relations distendues. Mais permet-elle pour autant à chacune d’entre elle de tirer parti de ce rapprochement ?
Elle tente, plus sûrement, de se couvrir des ors d’une culture admirée par l’intelligentsia mondiale. Elle se place en modèle d’une culture sulfureuse, assumée, brillante. Diabolique sans doute aussi. Femme symboliste inquiétante. Elle démontre en tout état de cause une utilisation étonnante de son savoir, de ses goûts, de ses orientations. Elle aurait pu choisir d’opter pour le contre-pied, l’affichage d’une culture « classique » qui, de part son décalage, n’aurait sans doute pas permis l’obtention d’un blanc-seing (noir-seing ?) de ses pairs cachés ou oubliés. Elle n’aurait pas été crédible, étrangement. Alors que dans son choix, tout est si sciemment calculé, que tout passe avec un naturel déconcertant. Elle n’hésite pas à se poser en « performeuse », reprenant une idée mise en forme par Cosey Fanni Tutti (une influence évidente) au sein de COUM (
Prostitution au ICA Arts Centre de Londres en 1976). Et pourquoi pas après tout ? On vous pardonne tous les excès si vous êtes capable de citer Klein, Rothko, Judd et Rauschenberg parmi vos artistes favoris…

Et pour parfaire le tout et mettre la dernière touche à la panoplie, elle est guitariste / chanteuse (version minimalisante dans les deux cas) au sein du groupe
Atelecine. Qui a osé dire qu’une œuvre de la série
La Sainte Vierge de Kendell Geers ferait une très belle pochette ?...