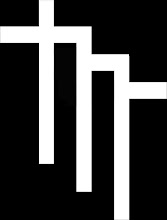Et ces autres nous interpellent d'autant plus qu'étant morts, ils n'en deviennent que plus présents. Le souvenir, l'oeuvre mais aussi l'aura sont intensifiés par la mort même. Elle les révèle, les sublime. Bien sûr, la mort de l'autre n'est que l'écho de notre propre mort mais elle transforme notre vision, nous éduque, nous apprend à mourir. La grande faucheuse nous fascine depuis la nuit des temps. Elle, l'insaisissable cavalière, provoque l'inexplicable, l'insoutenable, mais pourtant le fondement même de la vie. Que se passe-t-il quand certains plus que d'autres la sentent s'approcher, roder ? Les artistes, voyants rimbaldiens, voient-ils leur pratique s'altérer ou au contraire s'intensifier ? Qu'en est-il de Michael Jackson qui savait qu'une nouvelle tournée le "tuerai" ? Comment Hans Hartung, poussé par une pulsion de vie (Eros ?), réinvente-t-il sa technique et fait exploser, dans un jaillissement divin, les couleurs ? Pourquoi Felix Gonzalez-Torres décide-t-il de disparaître dans l'immensité céleste ? Peut-on finalement penser, comme Socrate, que c'est un "merveilleux gain de mourir" ? Pour soi ou pour les autres ?
L'exposition Deadline au Musée d'art Moderne de la ville de Paris vous plongera dans ces questionnements infinis et troublants. Réunir ces artistes par l'analyse des oeuvres réalisées à ce moment si crucial d'une vie où les jours sont comptés, semblait au départ tirer sur le pathos. Mais, déambulant de salle en salle, devant la grandeur et la puissance (ajoutée ou non) des oeuvres, un malaise vous serre. On ne sait plus si l'on marche dans un cimetière ou si l'on est déjà au royaume d'Hadès... La mort nous impose-t-elle une lecture biaisée des oeuvres ou a-t-elle réellement insufflé au travail de ces artistes un dernier élan de vie ?
Il en va de même pour le film This is it, présentant l'oeuvre ultime de Michael Jackson... Ce regard a posteriori se veut presque comme une hypertrophie du deuil, un besoin nécrophage, ou au contraire un refoulement, un déni.
Le chanteur se dévoile sous les traits d'un perfectionniste forcené, noyé dans une passion dévorante. Le travail arrassant qu'il s'impose, dans une posture christique, l'a conduit à sa déchéance. Il avait certainement une grande conscience, à l'instar des artistes présentés dans Deadline, de cotoyer chaque jour un peu plus la mort. Ce qui insuffle à son oeuvre une force incroyable, une sublimation, vers une c(h)ristallisation.
La mort est iconophile, elle s'incarne par l'image. Elle transparaît dans les dernières oeuvres d'artistes talentueux devenus génies. Mais ces images qu'on nous offre pour une ultime génuflexion cherchent-elles à animer le souvenir du mort lui-même ou du vivant ? Deadline et This is it ne sont-ils pas simplement des Memento Mori modernes ?